Société civile et fournisseurs d’eau exhortent la Commission Européenne de ne pas affaiblir ni supprimer les règles fondamentales en matière de protection de l’eau
Un collectif d’associations, représentant les trois piliers de la Stratégie européenne pour la résilience de l’eau, a publié le 18 février une lettre ouverte pour s’opposer à la révision de la Directive-cadre sur l’eau (DCE), annoncée par la Commission européenne pour le deuxième trimestre 2026.
Les signataires, dont des ONG environnementales et des acteurs du secteur de l’eau, dénoncent un risque d’affaiblissement du texte, alors que son application reste incomplète dans de nombreux États membres. « Plutôt que de réviser la DCE, il faut accélérer sa mise en œuvre », soulignant son rôle crucial pour la protection des écosystèmes, la sécurité alimentaire et l’adaptation au changement climatique.
La lettre met en garde contre une révision prématurée, qui pourrait être motivée par des pressions industrielles, notamment pour faciliter l’extraction de matières premières. Les associations appellent la Commission à maintenir un cadre juridique stable et à prioriser l’application des règles existantes.
- lire la lettre en anglais : Preserving water resilience, preventing the weakening of the Water Framework Directive, letter from civil society and NGOs
traduction d’extrait :
« Nous vous écrivons au nom d’associations représentant les trois piliers de la Stratégie européenne pour la résilience de l’eau, pour exprimer nos vives préoccupations concernant l’annonce, dans la communication sur le plan d’action RESourceEU, d’une révision de la Directive-cadre sur l’eau (DCE) au deuxième trimestre 2026. Nous exhortons la Commission à s’abstenir de rouvrir ou de modifier la DCE, ce qui risquerait de l’affaiblir, alors que l’accent devrait être mis sur l’accélération de sa mise en œuvre et de son application, comme indiqué dans la Stratégie pour la résilience de l’eau. »
« La résilience de l’eau est un pilier central de l’adaptation climatique et une condition préalable aux transitions écologique, numérique et économique de l’Europe, ainsi qu’à la sécurité alimentaire et à la réalisation du droit humain à l’eau et à l’assainissement. Nos organisations soutiennent la Stratégie européenne pour la résilience de l’eau, mais celle-ci ne peut être atteinte sans des objectifs juridiques solides. La stabilité légale est cruciale pour stimuler les efforts et les investissements nécessaires. »
Nous reconnaissons la nécessité pour l’UE d’accroître son autonomie en matières premières critiques, mais il est inacceptable de rouvrir la directive sans évaluer l’impact des changements proposés sur l’environnement, la santé des populations et d’autres secteurs, ni prouver que le cadre législatif actuel constitue un obstacle majeur aux nouveaux projets miniers. »
« La DCE, lorsqu’elle est correctement appliquée, aide à équilibrer les besoins concurrentiels en eau et à protéger la nature, réduisant la pollution et garantissant un bon état écologique et chimique des masses d’eau. Limiter la pollution des écosystèmes aquatiques et protéger les rivières, zones humides, glaciers, eaux côtières et lacs est essentiel pour la résilience future de l’eau en Europe. »
« Une société intelligente face à l’eau nécessite une cohérence réglementaire et une certitude juridique, permettant aux acteurs économiques d’évaluer les risques, de planifier les investissements et d’innover en toute confiance. Avec des pertes économiques annuelles liées aux extrêmes climatiques 2,5 fois plus élevées en 2020-2023 qu’au cours de la décennie précédente, l’urgence d’agir grandit. »
« Nous appelons respectueusement la Commission à :
- Ne pas rouvrir, modifier ou affaiblir la DCE ;
- Prioriser la mise en œuvre complète et en temps voulu de l’acquis communautaire existant ;
- Garantir un environnement réglementaire clair, stable et prévisible. »




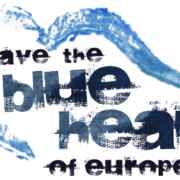



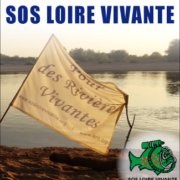


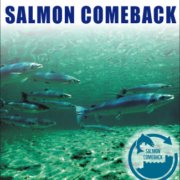

 ERN France
ERN France ERN is the official WWF Freshwater Partner in France and cooperates with WWF Switzerland, Austria, Netherlands and others
ERN is the official WWF Freshwater Partner in France and cooperates with WWF Switzerland, Austria, Netherlands and others
Plusieurs lobbies dont celui de l’agriculture, des mines, des affaires, voire certains États membres, tentent activement d’affaiblir la législation européenne sur l’eau. Ils affirment que ces lois sont trop coûteuses, entravent l’activité économique et compliquent les procédures d’autorisation.
Ces affirmations sont infondées et mettent en péril la directive-cadre sur l’eau (DCE).
Nous exhortons la commissaire Jessika Roswall à préserver l’acquis communautaire en matière d’eau et à rejeter TOUTE tentative d’inclure la DCE dans le prochain paquet Omnibus de simplification !
La sécurité hydrique de l’Europe dépend d’un cycle hydrologique fragile, déjà déstabilisé par la pollution, l’utilisation des sols, le pompage excessif et le changement climatique.
Protéger l’eau signifie garantir l’accès à une eau potable sûre, à des rivières saines et à une production alimentaire saine.
Il est essentiel de disposer d’une législation forte en matière d’eau. L’affaiblir n’est tout simplement PAS une option.